Introduction
Tous les indicateurs sont unanimes, le marché de la musique est bel et bien en crise. La musique numérique peine encore à compenser l'érosion des ventes de supports physiques, CD ou DVD, qui ne cesse de s'accentuer (voir les derniers chiffres avancés par le Snep). Suite à la transposition en droit français de la directive européenne EUCD, la question fait aujourd'hui l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les différentes forces en présence au travers de la désormais célèbre mission Olivennes, du nom du directeur général de la Fnac nommé à la tête d'une commission chargée de réfléchir aux méthodes à mettre en œuvre pour redresser la barre. Bien que certains parviennent à démontrer que téléchargement illégal et achat de musique n'ont rien d'incompatible, le P2P est toujours désigné comme la principale cause des maux de l'industrie musicale.Alors que les différentes mesures suggérées sont loin de faire l'unanimité au niveau des consommateurs, que les ventes de musique sur Internet n'augmentent que péniblement et que le téléchargement illégal est loin d'être résorbé, de nouvelles méthodes d'accès à la musique se mettent en place. Qu'ils s'appellent Deezer, SpiralFrog, Airtist ou MusicMe, ces services ont comme caractéristique commune la volonté de proposer de nouvelles modalités d'écouter légalement ses artistes préférés. En attendant que la musique connaisse des lendemains qui chantent, embarquons pour un tour d'horizon de la question, des propositions de la mission Olivennes aux offres du futur en passant par la question de la redevance pour copie privée...
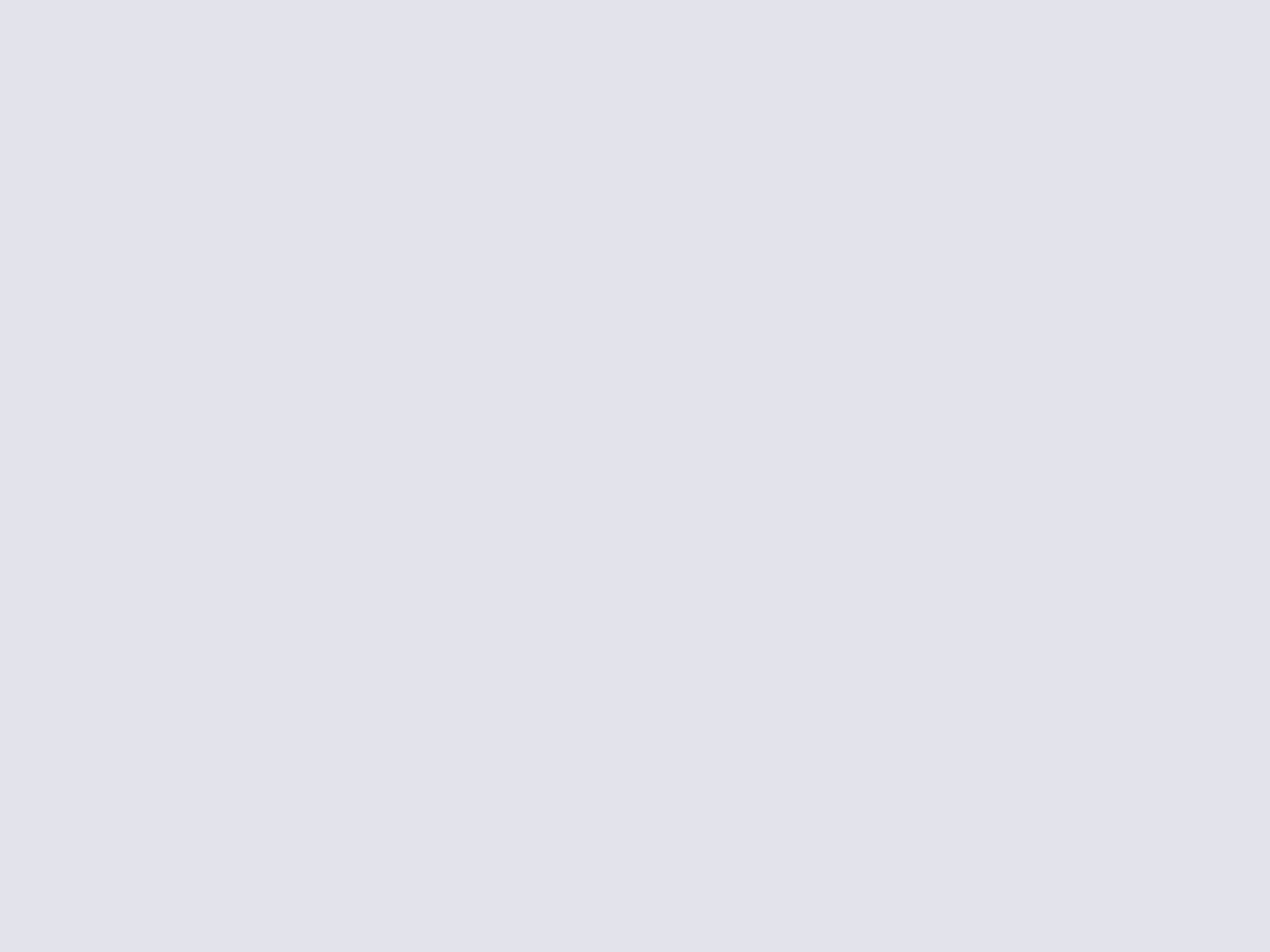
Mission Olivennes : quelles conséquences pour le consommateur ?

Le retour de la riposte graduée
Trois volets sont envisagés, à commencer par un dispositif de sanction basé sur le modèle de « riposte graduée ». Celui-ci prévoit l'envoi de courriers électroniques d'avertissement, puis la suspension temporaire, voire définitive, de l'abonnement à Internet de l'utilisateur incriminé en cas de récidive. « Les pirates professionnels », ceux qui font commerce d'oeuvres acquises illégalement, « resteront soumis au droit commun de la contrefaçon », a prévenu Nicolas Sarkozy lors de son discours.
Evincée des débats sur la loi DADVSI, la riposte graduée signerait ici son grand retour avec un barème prévoyant l'envoi de courriers électroniques d'avertissement, puis d'éventuelles lettres recommandées, avant la suspension temporaire de l'abonnement de l'internaute incriminé et, pourquoi pas, une résiliation pure et simple en cas de récidive. Le système de contravention, cause de l'invalidation de la loi DADVSI par le Conseil constitutionnel, disparaîtrait donc purement et simplement.
Pour mettre en place ce système de répression graduée, il est nécessaire de systématiser la détection des infractions puisque l'idée n'est pas tant de mettre fin aux agissements des utilisateurs compulsifs d'eMule que d'enrayer le piratage de masse. Autrement dit, il faut que le grand public ait peur de télécharger de façon illégale et qu'il sache qu'une épée de Damoclès plane au dessus de sa tête dès lors qu'il s'adonne à ce genre de pratiques.
Une autorité publique devrait être dévolue « à l'avertissement et à la sanction » des internautes, selon les termes du rapport Olivennes. Sur plainte des ayants droit, elle transmettra aux fournisseurs d'accès à Internet les courriers à faire suivre aux abonnés, puis se chargera des éventuelles sanctions en cas de récidive. Après approbation par la Cnil, elle constituerait un répertoire national des abonnés dont le contrat a été résilié visant à limiter la faculté de ces derniers à se réabonner chez un autre opérateur.
Les fournisseurs d'accès s'engagent de leur côté à jouer le jeu de ce système de riposte graduée tout en étudiant et expérimentant les différentes technologies de filtrage du réseau, avec une obligation partielle de résultats à 24 mois. Enfin, éditeurs de contenus et ayants droit acceptent au travers de cet accord de supprimer les verrous numériques qui sont un frein à l'interopérabilité dans le domaine de la musique et de calquer la sortie des films en vidéo à la demande sur Internet sur le calendrier de sortie des DVD de façon à favoriser le développement de l'offre égale.
Objection, votre Honneur
Les réactions au rapport Olivennes n'ont pas tardé, les organisations de défense des libertés individuelles ayant été, comme souvent, les premières à monter au créneau. La suspension de l'abonnement serait « contraire à plusieurs principes constitutionnellement garantis » selon l'UFC Que Choisir qui évoque « le respect de la présomption d'innocence et l'imputabilité des actes de téléchargement à l'abonné ». La ligue Odebi dénonce quant à elle le transfert des pouvoirs traditionnellement dévolus à la justice à une autorité qui serait censée assurer aussi bien l'avertissement que la sanction dans le cadre du régime de la riposte graduée.
D'autres ne manquent pas de souligner que Denis Olivennes, PDG de la Fnac, n'était peut-être pas la personne la mieux placée pour conduire une étude comme celle-ci dans la mesure où il est directement concerné par les mesures qui en découlent ; ce à quoi l'intéressé répond que les ventes de disque représentent aujourd'hui des sommes bien moins importantes pour la Fnac que les ventes d'ordinateurs, de matériels multimédia ou d'abonnements à Internet. « La Fnac a beaucoup plus intérêt au piratage qui enrichit les fabricants d'ordinateurs et les groupes de télécommunication ! En l'occurrence, c'est comme si le patron d'un groupe qui vend des engrais et des OGM avait rendu un rapport en faveur de l'agriculture biologique », rétorquait-il à Rue89 lors de la remise de son rapport à l'Elysée.
De l'art difficile du consensus
« Les pouvoirs publics sont toujours relativement prudents sur le dossier de la piraterie sur Internet », commente Bernard Miyet, président du directoire de la Sacem. « La question de la répression de masse est extrêmement sensible et l'on a donc tendance à établir un consensus pour minimiser le coût politique ». Autrement dit, les membres de la mission Olivennes ont dû trouver le moyen de formuler des propositions concrètes et transposables dans le droit français, tout en ménageant la chèvre et le chou. Pouvoirs publics, fournisseurs d'accès à Internet, télévisions, associations de consommateurs, sociétés d'auteur ou maisons de disque : chacun voit midi à sa porte et n'est prêt à accorder des concessions que dans la mesure où ses propres affaires ne sont pas mises en danger. Peut-on vraiment prendre le problème à bras le corps tout en ménageant les susceptibilités de chacun ?
Du côté de la musique, on ne manque pas de rejeter la faute sur les fournisseurs d'accès à Internet qui, pour promouvoir l'avènement du haut débit en illimité, ont axé leur communication sur la gratuité des contenus en ligne. En octobre dernier, la SPPF (Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France) fustigeait par exemple Free pour son service d'échange de fichiers en ligne, dl.free.fr, accusant le FAI de « donner un nouvel essor à la contrefaçon numérique dans un contexte où le marché du physique continue de chuter inexorablement ».
Le débat n'est pas nouveau. En réalité, l'objet même de la mission Olivennes n'est pas nouveau. L'on se souviendra par exemple qu'en juillet 2004, sous l'égide de trois ministres du gouvernement Raffarin, dont l'actuel chef de l'Etat alors ministre de l'Economie et des Finances, fournisseurs d'accès et maisons de disque s'étaient réunis à l'Olympia pour signer la « Charte d'engagements pour le développement de l'offre légale de musique en ligne, le respect de la propriété intellectuelle et la lutte contre la piraterie numérique ». Ce texte (document PDF) avait pour vocation de favoriser le développement de l'offre de musique légale sur Internet et de poser les bases d'une réflexion sur les méthodes à mettre en œuvre pour lutter contre le téléchargement illégal. N'y aurait-il pas comme un air de ressemblance ?
Des mesures réellement efficaces ?
Soutenues par le gouvernement et par le chef de l'Etat, les mesures préconisées par la mission Olivennes devraient faire l'objet d'applications concrètes dans le courant du premier semestre 2008. Les deux chambres auront donc la tâche de voter des textes de loi visant à instaurer certains de ces préceptes, à commencer par la création d'une autorité publique chargée de gérer le dispositif de riposte graduée. Bien que les conditions exactes d'application de ces mesures ne soient pas encore fixées, leur efficacité est déjà mise en doute.
La question du filtrage des réseaux par les FAI suscite par exemple de nombreuses interrogations techniques. En matière de téléchargement comme de protections contre la copie, les internautes ont bien souvent un coup d'avance sur les dispositifs censés les empêcher de s'adonner à leurs coupables passe-temps. Même si des procédures, extrêmement lourdes, d'analyse des paquets émis ou reçus par un internaute étaient mises en place, le chiffrement des informations permettrait sans doute de passer outre cette protection.
De la même façon, le blocage systématique des applications associées au téléchargement illégal limiterait peut-être l'usage chez les pirates à la petite semaine mais n'aurait probablement aucune incidence sur le comportement des amateurs avertis qui ne mettraient pas longtemps à se tourner vers d'autres protocoles. Le volet « riposte graduée » soulève lui aussi son lot d'interrogations. Quid de la présomption d'innocence, de l'usurpation d'identité et des erreurs techniques ? Dans quelles conditions serait administré le fichier des internautes convaincus de téléchargement illégal ? D'après une étude, 56% des Français (et non des internautes français) estiment toutefois qu'il « sera possible dans l'avenir de lutter contre le téléchargement illégal sur Internet ».
La seule mesure qui semble faire l'unanimité auprès des différents acteurs concernés par la question est celle qui préconise l'abandon des DRM (ou verrou numérique) même si, comme nous le fait remarquer Jonathan BENASSAYA, co-fondateur de Deezer, ni , ni Microsoft, n'ont participé à la concertation, alors qu'ils fournissent les deux principales solutions de protection contre la copie utilisées dans le domaine de la mesure (FairPlay chez Apple, Windows Media DRM pour Microsoft). « Si les fabricants ne sont pas capables de proposer un environnement ad hoc, il est impossible de développer le modèle de la musique sans DRM », ajoute-t-il.
« Il faut commencer par rendre le service légal aussi simple que l'offre en contenus illégaux. Avec l'aide des producteurs et des ayant droits, il faut mettre en place du contenu de bonne qualité avec la garantie de l'interopérabilité », milite Jérôme Giachino, directeur de StarZik.com, l'une des premières plateformes de musique en ligne françaises à avoir proposé le téléchargement de contenus sans DRM. « Une fois que ceci sera fait, on pourra dire aux gens de prendre leurs responsabilités en leur expliquant que le téléchargement illégal n'est pas excusable ». Valoriser l'offre légale est une chose, la rendre accessible à tous en est une autre. D'autant que certaines notions comme « l'exception pour copie privée » compliquent la donne au niveau du consommateur...
Copie privée : un mal nécessaire ?
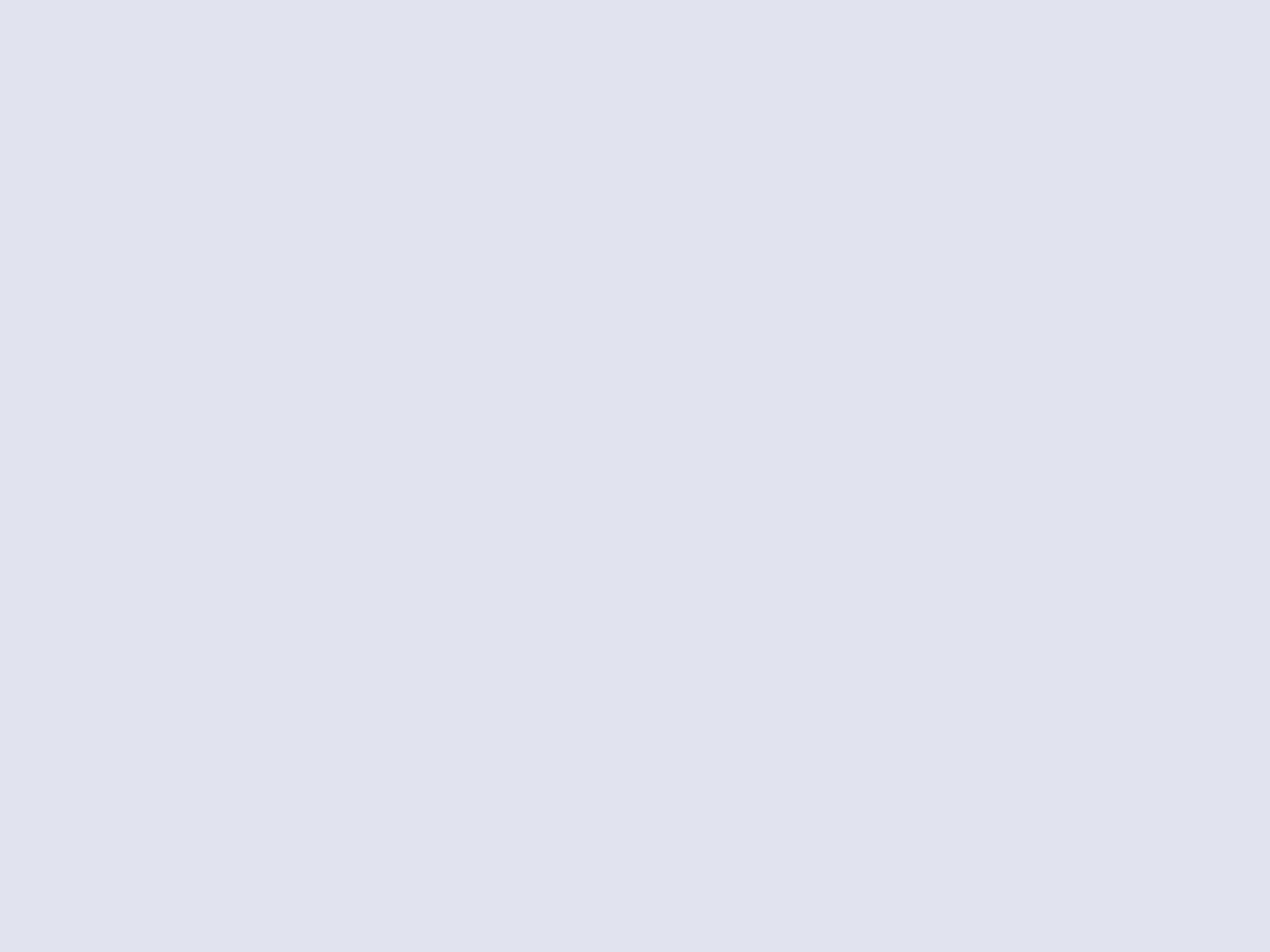
Pourquoi la copie privée ?
La redevance pour copie privée est perçue depuis 1985 pour chaque support de stockage (analogique, puis numérique) ou dispositif permettant de copier des oeuvres musicales ou multimédia. Autrement dit, le prix de ces produits dans le commerce comporte une part réservée aux organismes chargés de la rémunération pour copie privée. Cette somme est ensuite distribuée entre différents producteurs et sociétés d'auteurs. Ces dernières divisent une partie de la somme qui leur revient entre les artistes qu'elles représentent et utilisent le reste pour financer des manifestations culturelles.
La redevance pour copie privée part du principe que l'on tolère la copie des oeuvres culturelles lorsque celle-ci se cantonne à la sphère privée (comprenez la famille), mais qu'il convient d'indemniser les ayant-droits pour le potentiel manque à gagner consécutif à cet acte. Pour faire simple, votre cousin aurait pu acheter l'album que vous lui avez gravé sur un CD de données. Isolée, la copie n'a aucune répercussion, mais elle doit selon les sociétés de droit d'auteur telles que la Sacem être prise en compte dès lors qu'une soixantaine de millions de consommateurs sont en mesure de la pratiquer.
Montants et perceptions ?
Le montant de la redevance est défini pour chaque catégorie de support de stockage ou de dispositif d'enregistrement par une commission. Présidée par Tristan d'Albis, celle-ci est composée de douze représentants des sociétés d'auteur, des fabricants et d'associations de consommateurs, qui se réunissent régulièrement pour décider des barèmes à appliquer. Derniers produits concernés : les Disques durs multimédia, auxquels seront prochainement appliqués une redevance de 7 euros pour les modèles de moins jusqu'à 80 Go et de 23 euros pour les disques de 400 Go et plus, avec différents paliers intermédiaires.
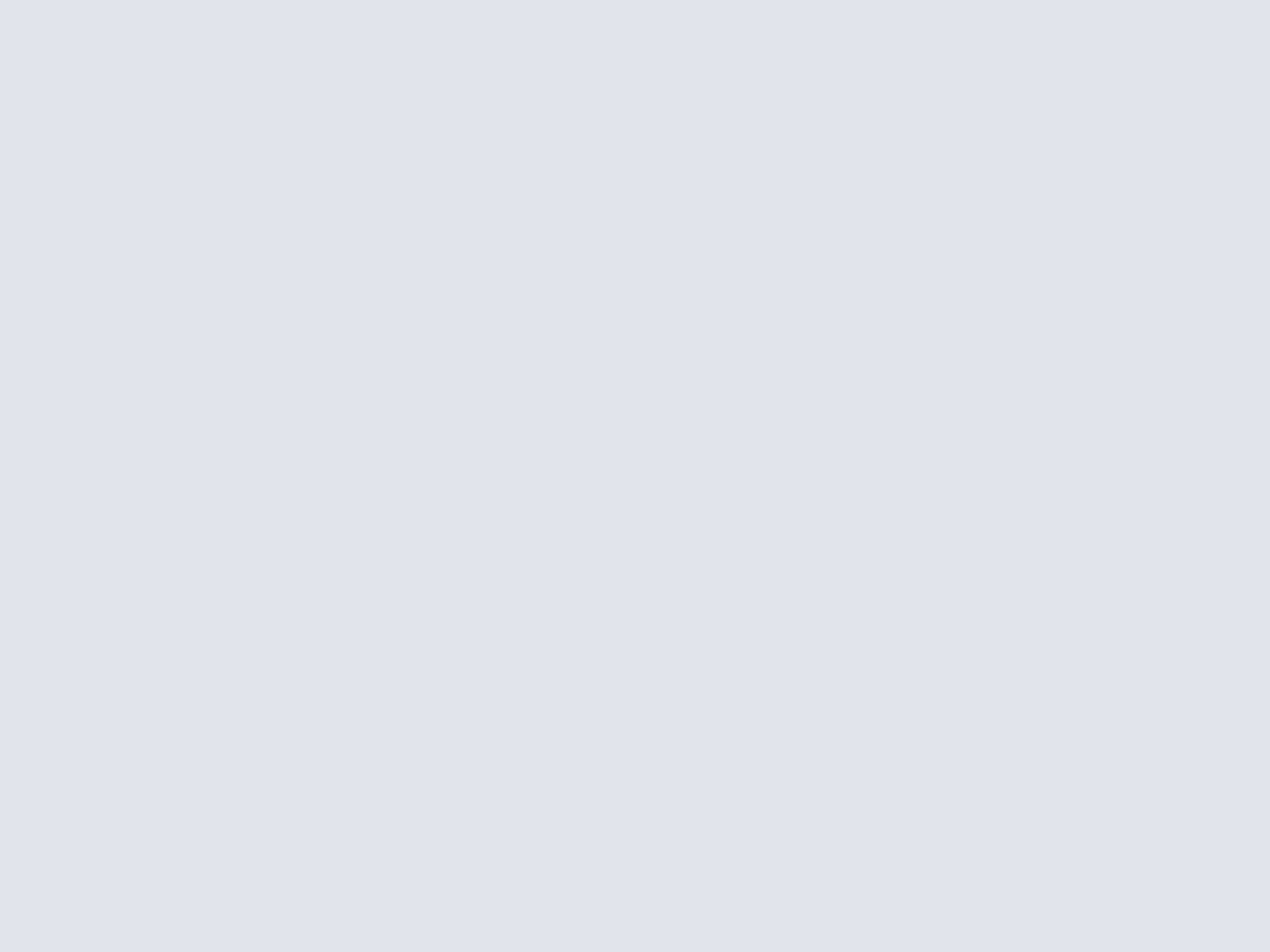
« Pour 2006, le total des perceptions liées à la rémunération copie privée se montait à 157 millions d'euros », commente Charles-Henri Lonjon, secrétaire général de la Sorecop et de Copie France, les deux organismes chargés de la perception en France (la Sorecop se consacre à la copie privée associée aux oeuvres sonores alors que Copie France traite la redevance liée à l'audiovisuel). « En 2007, elle devrait avoisiner 154 millions d'euros selon nos prévisions. Pour 2008, une baisse sensible, d'environ 10%, est attendue ». Pourquoi cette baisse alors que le marché de l'électronique grand public ne cesse de progresser ?
En réalité, les montants perçus devraient rester stables dans le domaine de l'audiovisuel, mais baisser du côté de la musique, nous explique Thierry Desurmont, vice président du Directoire de la Sacem et membre de la commission d'Albis. « Avant, l'essentiel de la rémunération venait des CD de données, mais les appareils d'enregistrement à support de stockage intégré, tels que les baladeurs, sont en train de se substituer à eux ». Problème : quand le consommateur achetait une, puis deux, dizaines de CD de données, il se contente d'un unique baladeur, auquel on ne peut appliquer une redevance qui serait calculée en proportion du montant qui était perçu sur un CD, à moins d'obtenir des montants préjudiciables aux affaires des fabricants.
Plutôt que d'uniquement étudier la capacité, la Commission d'Albis essaie donc d'envisager les usages qui sont faits de chaque appareil ou support de stockage, d'où la distinction opérée entre CD vierges audio et CD de données par exemple. Un produit est-il exclusivement dédié à l'enregistrement d'oeuvres protégées, comme un baladeur par exemple (support dédié), ou sert-il aussi au stockage de données personnelles, non soumises à la redevance comme une carte mémoire (support hybride) ? Quoi qu'il en soit, la baisse des revenus issus de cette redevance semble plus ou moins inéluctable.
La copie privée attaquée en Europe ?
Dès lors, l'objectif est double pour les sociétés d'auteur : faire accepter la notion de copie privée au citoyen lambda et trouver une solution à la baisse des revenus qu'entraine la dématérialisation des contenus. Le premier passera par la mise en place d'une importante campagne de communication destinée à sensibiliser les consommateurs ainsi que par la création d'une association « La Culture avec la copie privée », qui rassemblera tous ceux qui veulent soutenir le principe de cette redevance. Pour le second, les choses s'annoncent nettement plus ardues, d'autant que les fabricants viennent de lancer leur offensive contre la copie privée au niveau européen.
Début novembre, quatre fabricants déposent à quelques jours d'intervalle quatre plaintes auprès de la Commission européenne. Chacune d'entre elles concerne un état différent. Aux Pays-Bas, c'est qui lance les hostilités alors que Philips se charge de l'Espagne et qu'Amazon s'occupe de l'Autriche. La dernière plainte, qui n'est pas encore publique, concerne la France. Dans les quatre affaires, c'est la direction générale Industrie qui a été saisie. Motif de la plainte ? Cette redevance serait contraire au principe de libre circulation des marchandises et des biens.
Ce n'est pas la première fois que la copie privée se voit attaquée au niveau européen. En décembre 2006, Charlie McCreevy, commissaire européen responsable du Marché intérieur et des Services, a par exemple proposé une recommandation prônant la suppression du principe de redevance pour la copie privée. Rejetée, cette proposition pourrait d'après certaines sources autorisées revenir occuper les débats, surtout si ceux-ci sont attisés par le dépôt quasi-simultané de quatre plaintes.
Les ayants-droit défendent pourtant toujours le bien fondé de la copie privée. Pour ce faire, ils s'appuient notamment sur une étude commanditée par le Gesac (qui regroupe 34 des plus importantes sociétés d'auteurs d'Europe) à un cabinet espagnol, qui affirme que les systèmes de copie privée actuellement en vigueur sont justifiés, bénéfiques dans la mesure où ils soutiennent la création, et qu'ils ne posent aucun problème avec le marché intérieur. Enfin, ils ne porteraient pas atteinte aux affaires des fabricants de supports de stockage. Ces derniers ne manqueront sans doute pas de soupçonner d'habiles élisions dans le traitement du sujet dans la mesure où l'étude a été commanditée par l'une des forces en présence. Quoi qu'il en soit, la loi maintient aujourd'hui le dispositif de rémunération pour copie privée.
Totale confusion pour le consommateur
Si le secteur de l'électronique grand public lutte contre le principe de la redevance pour copie privée, le grand public n'est pas en reste. Le consommateur déplore en effet que l'on majore les prix des périphériques et autres supports destinés au stockage au nom du droit à la copie privée alors que les maisons de disque restreignent ce même droit par l'utilisation de mesures techniques de protection, dont le contournement reste passible de sanctions au regard de la loi DADVSI. Conséquence : ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des distributeurs étrangers lorsque vient l'heure d'acheter des CD ou des DVD vierges.
Les différences de prix significatives observées d'un pays à l'autre compensent en effet largement les éventuels frais de port occasionnés par un envoi depuis l'Angleterre, l'un des trois pays à ne pas pratiquer l'exception pour copie privée et la redevance qui lui est associée... A l'heure du marché commun, il parait extrêmement difficile de limiter les échanges d'un pays à l'autre, même si les sociétés d'auteur apprécieraient de mettre un terme à ce marché gris. Sans surprise, elles indiquent que la rémunération perçue au nom de la copie privée devrait dépendre du pays de résidence de l'acheteur et non de l'état dans lequel est effectué l'achat.
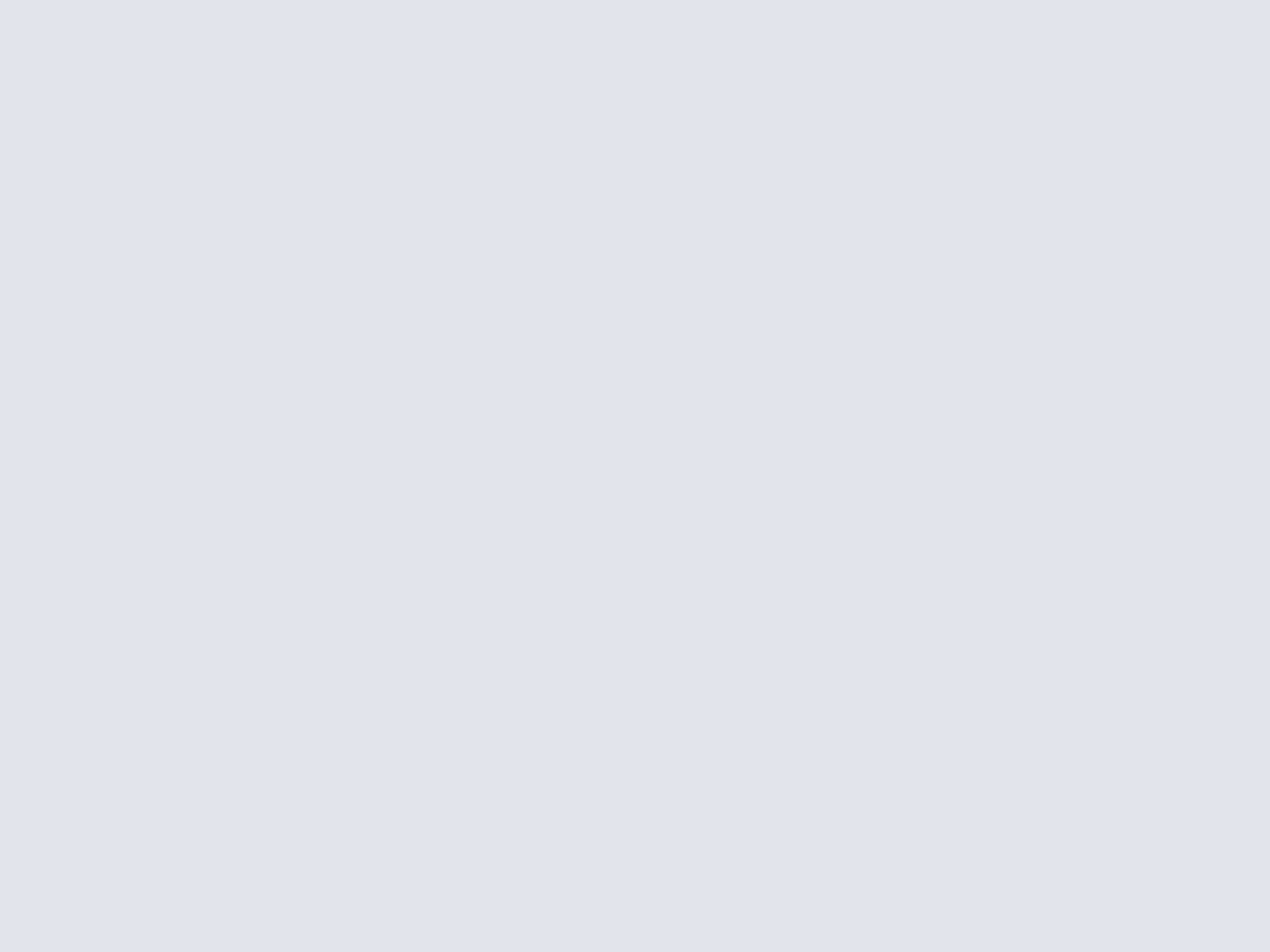
Un autre motif d'incompréhension vient du marché de la musique numérique, le consommateur ayant l'impression de payer deux fois sa musique : une première fois, en ligne, lors de l'acte d'achat et une seconde fois au travers de la redevance pour copie privée. « Il est exact que les consommateurs paient deux fois mais il n'y a pas de double paiement car ils paient pour deux actes différents : le téléchargement initial pour lequel les détenteurs de droits sont rémunérés via une redevance sur le prix de vente, collectée pour leur compte par leurs sociétés d'auteurs, et la copie ultérieure de la musique achetée », répond le Gesac. « Ce second acte qui tombe sous le coup de l'exception pour copie privée et donc hors du champ du droit exclusif de reproduction, est par conséquent rémunéré via un système de rémunération pour copie privée », ajoute le groupe européen avant de faire remarquer que l'on retrouve la même dichotomie avec les CD physiques.
« La copie privée doit être défendue pour les ayant droits et les organisateurs de manifestation qui comptent sur les 25% qui leur reviennent », martèle Thierry Desurmont. Avant de rappeler le principe de répartition de cette redevance gérée par la Sorecop : 50% pour les auteurs, 25% pour les artistes et 25% pour les producteurs. « Sans ces fonds, la culture se verrait largement appauvrie », conclut-il. Baisse prévisible des revenus, dématérialisation de la musique et attaques concertées des parties en présence finiront sans doute par conduire, à plus ou moins long terme, à une réforme des systèmes de redevance pour copie privée.
De nouveaux modèles pour la musique en ligne

« Chez les artistes, règne l'omerta », grogne Jean-Louis Murat, avec le franc parler qui le caractérise, dans une interview accordée au journal Le Monde fin novembre. « Dès qu'ils dénoncent les pratiques de voyou sur Internet, ils sont attaqués par des petits groupes d'internautes ; ceux-ci s'y mettent à une dizaine, se font un plaisir de mettre la totalité de la discographie de l'impétrant à disposition gratuitement, partout, dernier album compris ».
L'un de ces « petits groupes » a pour nom le Parti pirate français, créé en mars 2006 et bien décidé à poignarder cette notion de droit d'auteur que Beaumarchais a contribué à mettre en place. Au nom des libertés individuelles et du droit de chacun à l'anonymat, il prône la libre circulation des œuvres et des informations, la suppression du concept de copyright (droit à la copie) et le droit au partage de toutes les œuvres de l'esprit. Abolir les lois sur la propriété intellectuelle en vigueur actuellement et se débarrasser de la notion de droit d'auteur pour mettre en place un nouveau modèle qui tiendrait compte des spécificités d'Internet.
Cette position a peut-être le mérite de soulever le problème de la propriété intellectuelle à l'heure de l'avènement des technologies de l'information et de la communication, mais elle ne suscite chez Murat que ce commentaire désabusé : « Cette conception ultralibéraliste, qui est au-delà de tout système politique, se résume à peu : la goinfrerie. Internet favorise cela : toujours plus de sensations, toujours plus de voyages, de pénis rallongés, toujours plus de ceci, de cela... ».
S'il ne va pas jusqu'à se réclamer de l'abolition du droit d'auteur, l'internaute n'éprouve aucune difficulté à justifier ses activités illicites en matière de téléchargement et ne recule devant aucun argument, même les plus spécieux. Tout d'abord, la musique est trop chère. Ensuite, elle est aujourd'hui à la solde des émissions de TV réalité et ne laisse plus s'exprimer les véritables artistes. Enfin, elle repose sur un modèle injuste dans lequel ce sont les maisons de disque qui s'engraissent sur le dos des musiciens et des artistes. Dans ces conditions, décomplexé comme il est, pourquoi irait-il acheter des CD ?
Maisons de disques, ou le carcan de la musique ?
D'aucuns estiment que « l'omerta », la loi du silence en vigueur chez les artistes selon Murat, ne concerne pas tant les internautes qui téléchargent que les maisons de disques qui tiennent les rênes du marché. Impossible pour un chanteur de se séparer de sa major, sous peine de voir cesser les campagnes de publicité, les contrats pour se produire sur scène et les éventuels passages en TV, expliquent-ils. Certains tentent le pari de l'autoproduction, avec plus ou moins de succès. Lorsqu'on s'appelle Radiohead ou Barbara Hendricks et que l'on est précédé d'une réputation internationale, on peut se permettre de quitter sa maison de disques et de laisser les internautes fixer eux-mêmes le prix de son dernier album, mais tous n'ont pas cette chance.
Fin 2006, le chanteur Mano Solo décide de donner un coup de pied dans la fourmilière et de tester le degré d'engagement des consommateurs tout en montrant que produire un CD n'est pas un acte anodin ou gratuit. Plutôt que d'en appeler aux fonds de sa maison de disques de l'époque, Warner, il invite les internautes à acheter son album avant sa sortie de façon à financer la réalisation de ce dernier. « Demandez-lui combien il en a vendu », commente, un brin caustique, Bernard Miyet, de la Sacem.
Force est de constater que l'opération se solde par un échec, comme le reconnaissait Solo lui-même début février dans un entretien au magazine FrancoFans : « Ca ne marche pas bien. Pour l'instant, ce n'est pas grave, c'était pour payer la promo et l'affichage et tout ça, mais je peux encore en vivre. D'un côté, je suis content que ça ne marche pas trop, car ça fait prendre conscience du leurre Internet ». Le leurre que Mano Solo dénonce, c'est celui qui ferait croire qu'Internet est un moyen de sensibiliser les foules sur la valeur de la musique. « Si tu dis au public que s'il ne paie pas, ça meurt, les trois quarts s'en branlent », résume-t-il avant d'admettre qu'il envisage le retour à la case maison de disques, seul moyen de continuer à publier des disques sans être obligé de « démarcher » les internautes.
L'essor des modèles gratuits
Comment concilier les inconciliables envies de gratuit des internautes et besoins de rémunération du secteur ? Si de nombreux médias - Clubic et sa maison mère sont du nombre, services, réseaux et espaces de discussion parviennent à financer leurs activités par la publicité, pourquoi ne pas appliquer ce modèle à la musique ? En gestation depuis 2006 avec Spiralfrog, la musique financée par la publicité arrive en 2007 sur Internet avec des services comme Deezer ou Airtist. L'idée défendue par les promoteurs de ces services est toujours la même : l'internaute ne rechignera pas à quelques publicités s'il a la possibilité de profiter gratuitement et légalement d'une offre de meilleure qualité de ce que lui propose le téléchargement illégal comme en proposent Jamendo, Spiralfrog ou Airtist.
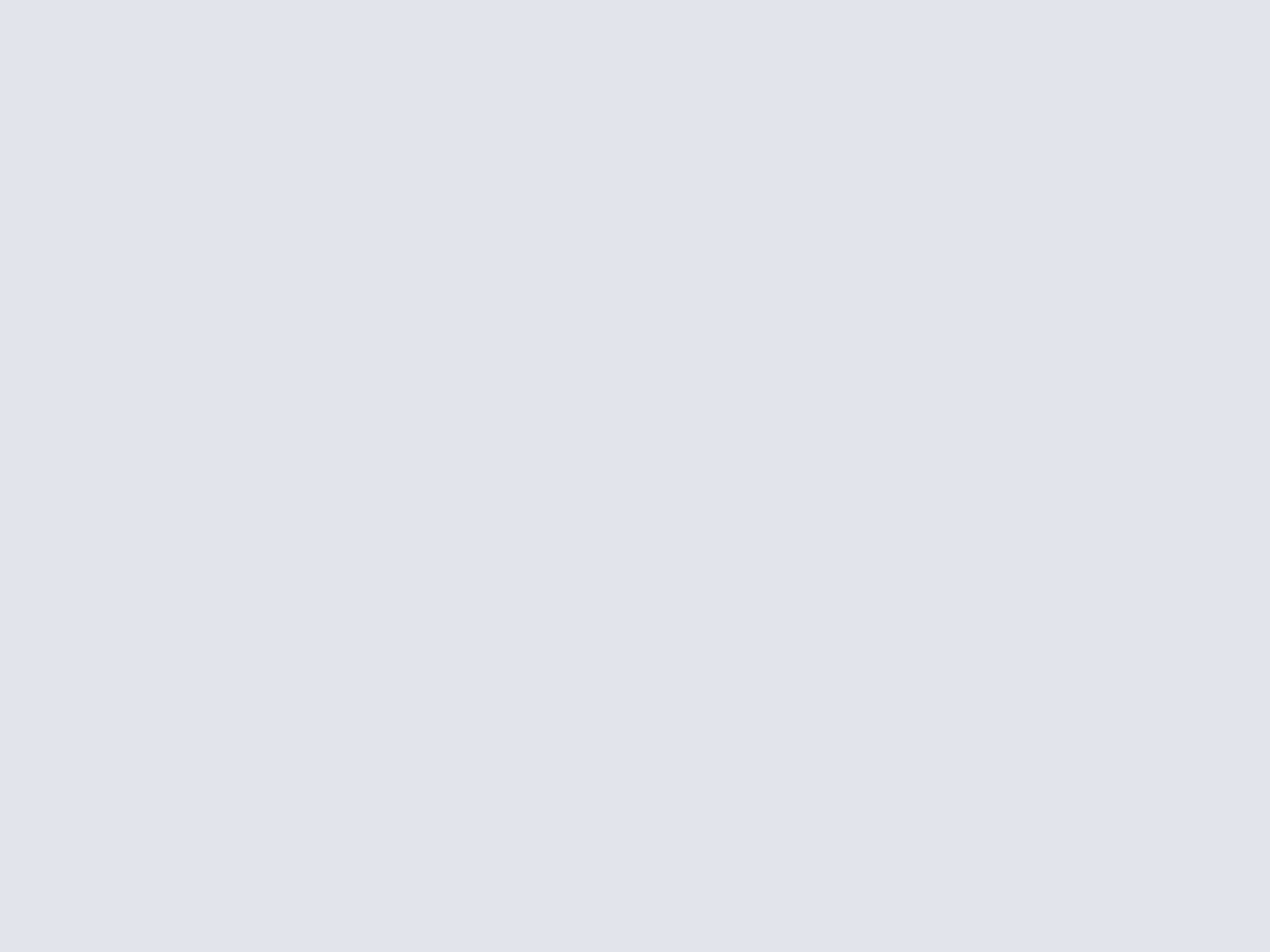
Airtist, plus fort que Spiralfrog ? La start-up française propose depuis quelques jours un modèle similaire à celui de Spiralfrog, mais chez elle, les morceaux sont proposés en MP3, sans protections contre la copie, et donc sans gestion précise de l'utilisation faite du fichier. Un artiste qui accepte que ses morceaux soient proposés gratuitement au téléchargement toucherait 5 centimes d'Airtist, la société versant par ailleurs 7 centimes par morceau à la Sacem. Musiciens et chanteurs ont en parallèle la possibilité de vendre leur musique sur Airtist. La plateforme leur laissant toute latitude pour déterminer le prix de chaque morceau et leur reverse 70% du prix de vente. Jamendo va plus loin en proposant à chaque artiste qui le souhaite de voir sa musique financée par de la publicité, 50% des revenus lui étant directement reversés.

Si Spiralfrog indique avoir ajouté 300.000 nouveaux titres à son catalogue ces derniers mois, le site ne communique aucune statistique quant au nombre d'utilisateurs, et ne compte qu'Universal parmi les quatre grandes majors du disque. Airtist fait logiquement preuve d'optimisme à l'ouverture de son service de musique financée par la publicité, mais devra parvenir à étoffer son catalogue gratuit, qui ne compte aujourd'hui qu'environ 20.000 titres. Malheureusement, il semble difficile de garantir à une maison de disques les mêmes marges que celles obtenues lorsque l'on vend un morceau un euro pièce avec le simple affichage de publicités, à moindre de rendre le service tellement chargé qu'il en devient inutilisable.
Le CPM (coût pour mille) accordé par les annonceurs et les régies parait toutefois suffisant pour compenser la simple écoute en streaming, comme en témoigne le succès de sites comme Deezer (France) ou Imeem (Etats-Unis). Ces services permettent à l'internaute d'écouter librement la musique de son choix depuis son ordinateur connecté à Internet, mais interdisent le téléchargement. Ils sont rémunérés grâce à l'affichage de publicités sur leurs pages, la majeure partie des sommes reversées allant théoriquement aux sociétés d'auteurs qui se chargent ensuite de la redistribution aux artistes. Ces « radios » personnalisables sont soumises au même régime que leurs aïeules de la bande FM : les écoutes sont comptabilisées de façon à ce que l'on puisse déterminer quelle somme revient à tel ou tel artiste.
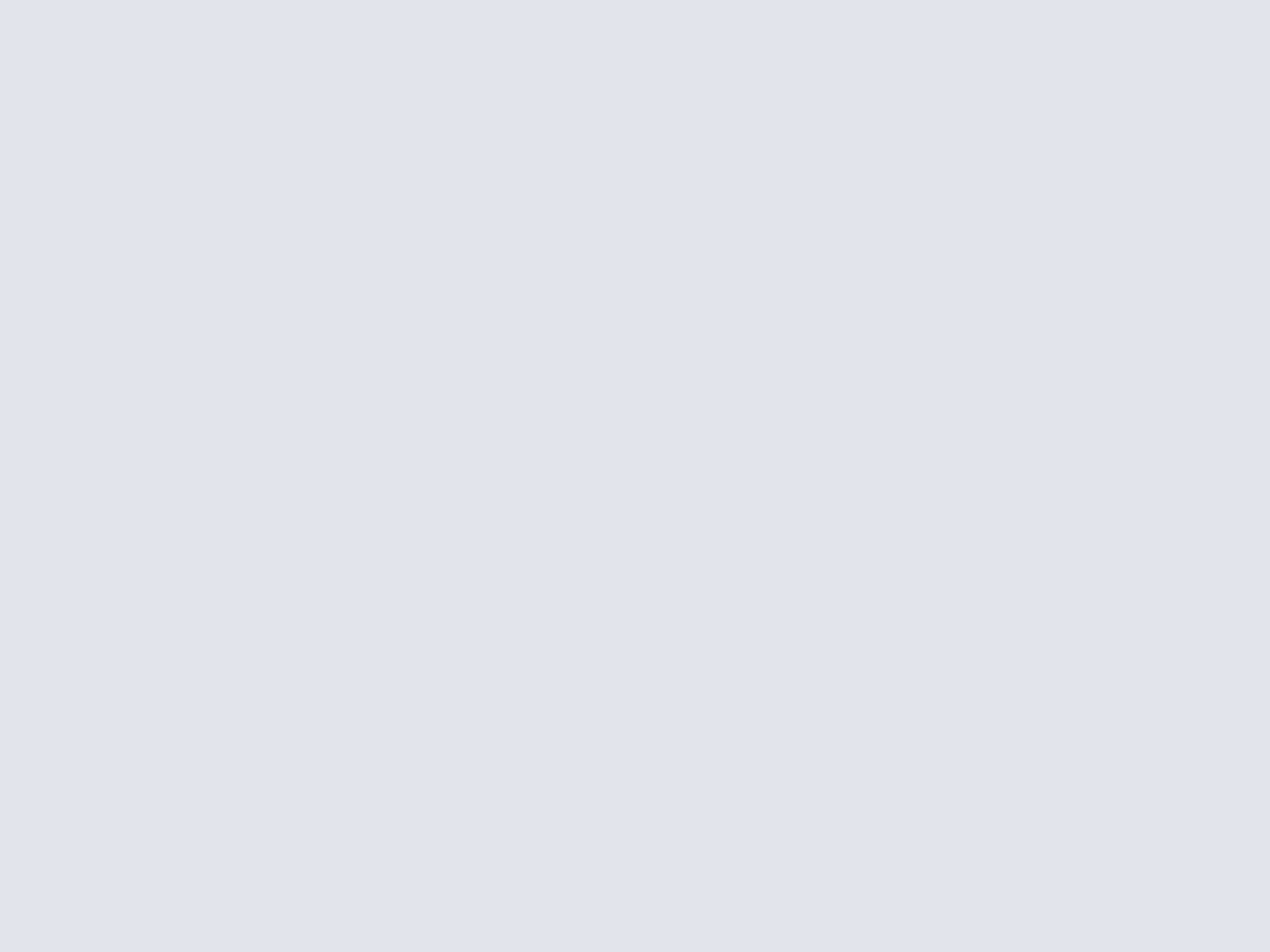
Romain Moyne, à peine vingt ans, aimerait suivre la voie tracée par Deezer avec You.dj, un service similaire lancé fin novembre. Lui aussi offre un streaming gratuit mais à la différence de Deezer, il n'a pas signé avec les ayant droits, ce qui vient de lui valoir une mise en demeure. Il indique être déjà entré en contact avec certaines sociétés d'auteur, « mais il est difficile d'être pris au sérieux lorsque le service n'a pas encore été lancé et que l'on ne peut pas justifier d'une audience suffisante ».
Impossible donc de signer lorsqu'on ne peut justifier d'un certain chiffre d'affaires mais... impossible de se lancer sans avoir passé un accord avec les sociétés d'auteur ! « Dorénavant, la SPPF aura une attitude très ferme à l'égard des sites ou des opérateurs utilisant des phonogrammes ou des vidéo-musiques en infraction avec les droits de producteurs de musique et elle agira promptement à leur encontre dès lors qu'elle aura constaté des actes de contrefaçon », menaçait début décembre la Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France. Le service RadioBlogClub, directement concerné par ces menaces, vient de prendre la décision de jouer le jeu de la SPPF en la submergeant de demandes d'autorisation pour chacun des morceaux qu'il diffuse.
Bien que frileuses, les maisons de disques finissent finalement par accepter de céder une partie de leur catalogue à ces nouveaux venus qui prétendent pouvoir compenser par la publicité la baisse des ventes de disques. Le modèle du tout payant aurait-il fait son temps ?
Conclusion : la musique payante a-t-elle fait son temps ?
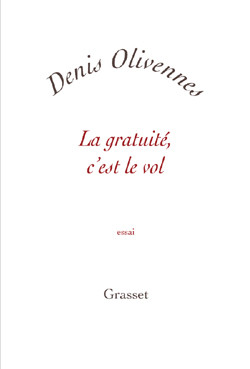
La gratuité c'est le vol : quand le piratage tue la culture, titre du dernier ouvrage publié par Denis Olivennes (mars 2007, Grasset), laisse à lui seul supposer que le PDG de l'un des principaux distributeurs de biens culturels en France entend se battre pour que l'on maintienne l'ordre des choses. Ce précepte, selon lequel l'œuvre artistique ou culturelle est en danger dès lors qu'elle est diffusée sans contrepartie, ne fait cependant pas l'unanimité. On pourrait en effet objecter à Denis Olivennes que loin de détruire toute valeur, l'essor du téléchargement illégal et des réseaux d'échange de fichiers a contribué à en créer de nouvelles qui, certes, profitent plus aujourd'hui aux fabricants de baladeurs et aux opérateurs de télécommunications qu'à l'industrie de la culture.
« Le P2P induit une inversion des subventions : traditionnellement, et dans le cadre de l'exception culturelle, ce sont les diffuseurs qui subventionnent les producteurs alors que sur Internet, les fournisseurs d'accès et les opérateurs de télécommunication sont financés par les contenus - via l'utilisation sans droit des œuvres - et s'enrichissant aux dépens des industries culturelles », commente Denis Olivennes.
Il insiste par ailleurs sur l'idée que c'est grâce au commerce et à la monétisation de la culture que le plus grand nombre est aujourd'hui en mesure d'y accéder. Sans commerce, pas d'argent, pas de rémunération des artistes, pas de production, pas d'album. Ses détracteurs affirment quant à eux que l'œuvre d'art est par essence gratuite, et que c'est la diffusion, le « partage », de cette dernière, qui lui confère une valeur, et non les campagnes de publicité consenties par une maison de disques. Derrière le « libre accès à la culture pour tous » se cache pourtant toujours un généreux donateur : mécène, état, fondation ou... artiste peu soucieux des contingences matérielles. Et pourtant, le consommateur n'aspire qu'à des contenus gratuits.
« La radio, la télévision, Internet sont d'immenses salles de spectacles ouvertes à tous les vents. Et leur gratuité n'est pas un vol, mais un formidable moyen de créer de nouvelles sources de revenus ; par la publicité, les sonneries téléphoniques, les instruments de musique ; et bien d'autres qui, s'inventent ailleurs », écrivait fin novembre sur son blog l'économiste Jacques ATTALI, qui défendait déjà cette idée fin janvier à l'occasion du salon international de la musique (Midem).
De nouveaux modèles seraient donc à mettre en place. L'un d'eux, médiatisé lors des débats autour de la loi DADVSI et désormais connu comme le concept de « licence globale », permettrait l'échange de contenus sur Internet en contrepartie d'une rétribution forfaitaire qui serait par la suite partagée entre les différents ayant droits. Séduisante au premier regard, la licence globale soulève toutefois de nombreux problèmes, à commencer par la difficulté de rémunérer avec exactitude les artistes en fonction de l'usage qui est fait de leurs œuvres. Un autre consisterait à instaurer une sorte d'exception pour copie privée au niveau des fournisseurs d'accès à Internet : puisque ceux-ci profitent indirectement du téléchargement des œuvres, il ne parait pas illogique de les faire contribuer à la rémunération des artistes.
Pour Jacques Attali, Philippe Axel, auteur de La Révolution musicale, ou le journaliste Florent Latrive, à l'origine du livre Du bon usage de la piraterie, il parait finalement vain de lutter contre l'extension de la gratuité, dont la portée dépassera l'univers de la musique. Si le consommateur refuse de payer, il faudra donc trouver d'autres sources de revenus : vendre des iPod déjà remplis de musique, taxer les fabricants de matériels, inciter les amateurs de musique à se rendre à un concert en joignant un CD à leur billet ou vendre des produits dérivés. Philippe Axel appelle cela le « transfert de ressources ».
Alors, faut-il vendre la musique comme n'importe quel bien de consommation ou, du fait de son caractère immatériel, de sa capacité à être partagée sans que le donateur soit privé de son exercice et de sa nature artistique, lui accorder un traitement particulier ? Cette question devrait sous-tendre une bonne partie des débats de l'édition 2008 du Midem, fin janvier à Cannes. Tandis, que les différents acteurs concernés militent à leur façon pour que les lois soient aménagées dans un sens qui leur soit favorable, comme en témoigne les manœuvres de séduction entreprises par l'IFPI pour faire imposer un filtrage du P2P au niveau européen ou, celles, vieilles de plus d'un an, de Vivendi Universal auprès de l'Assemblée Nationale... un pan tout entier de l'industrie culturelle attend la réponse à cette question. La balle est désormais dans le camp des politiques, qui vont avoir la charge d'élaborer les textes et décrets d'application des recommandations Olivennes.
