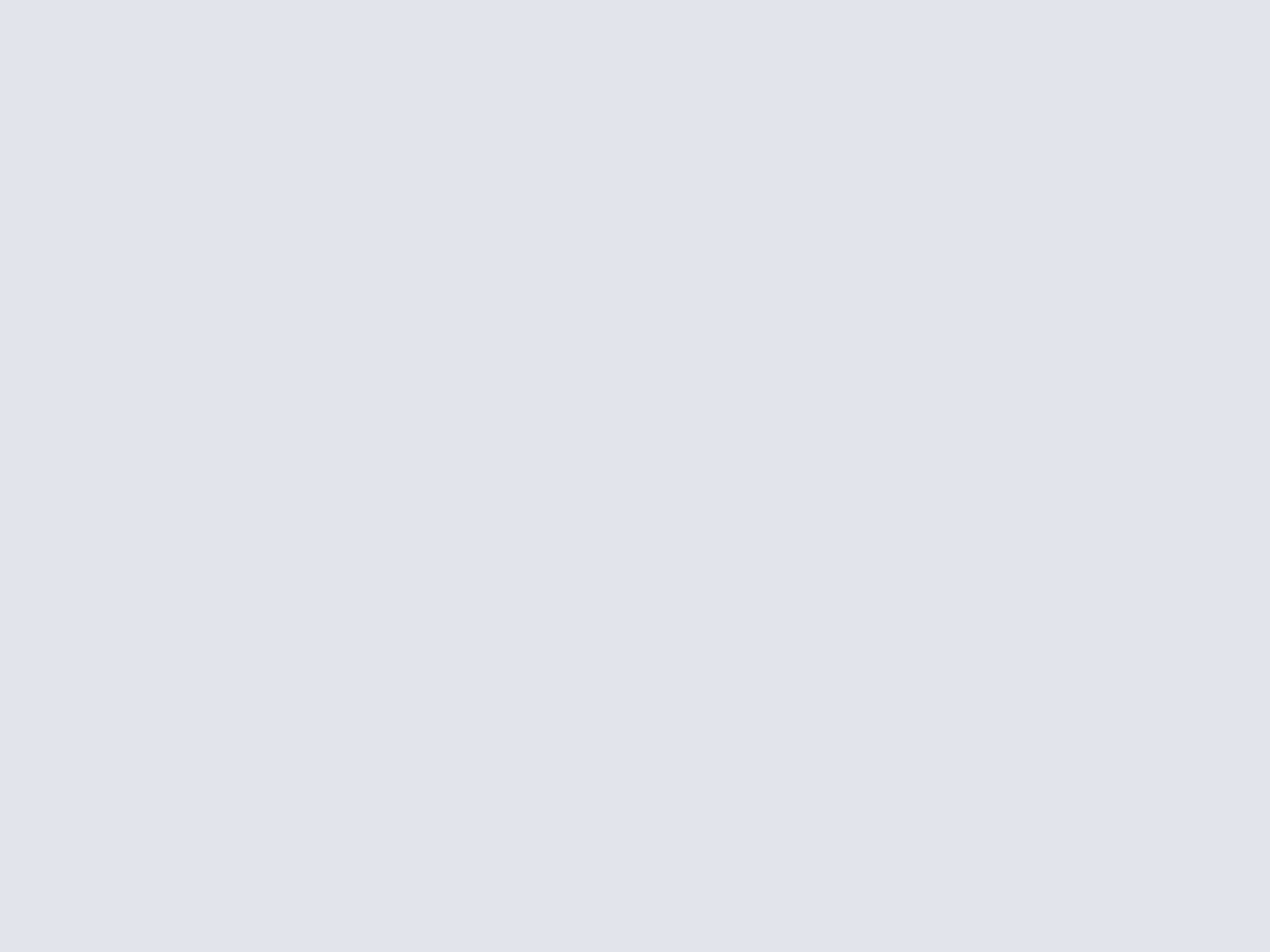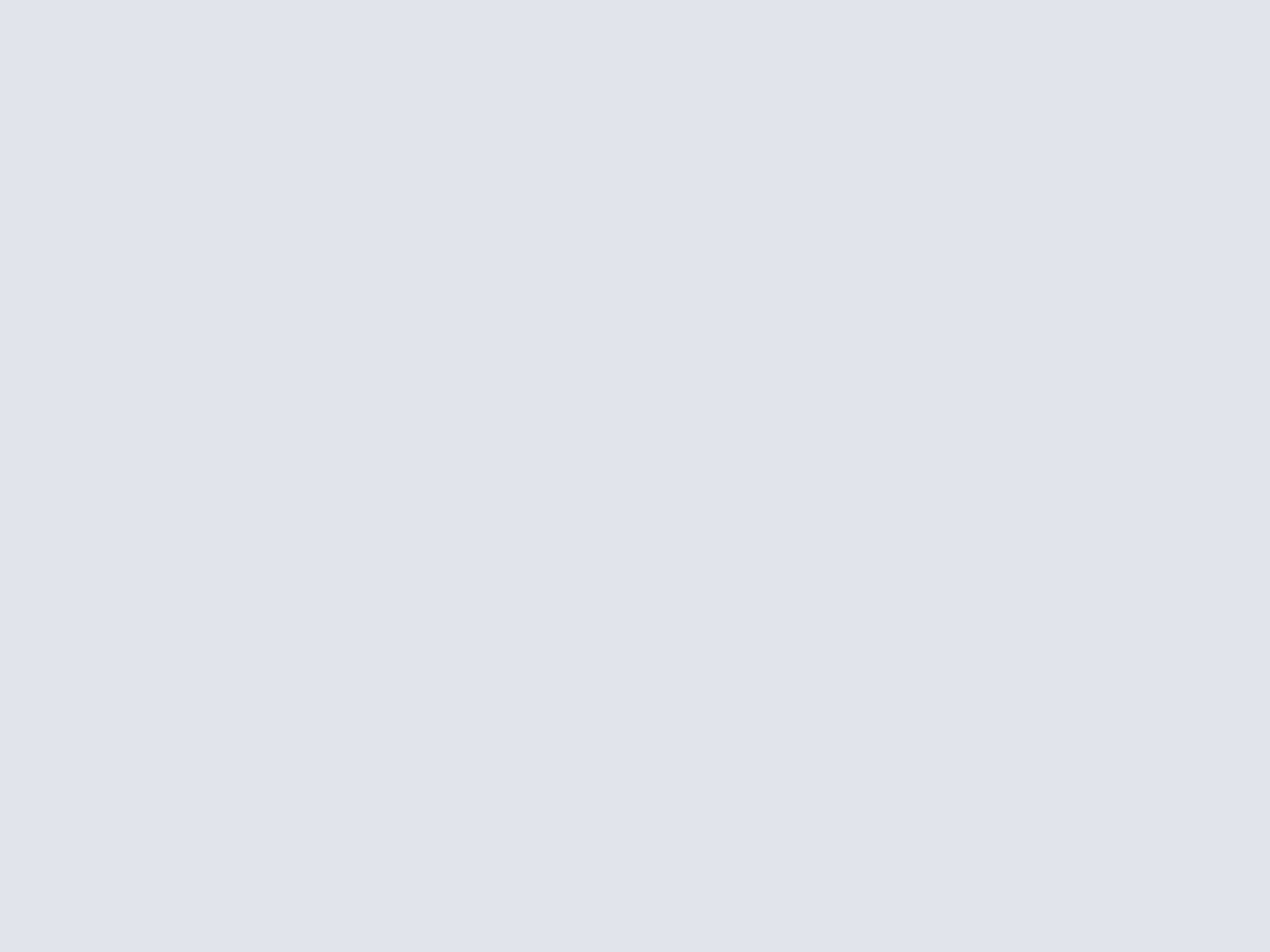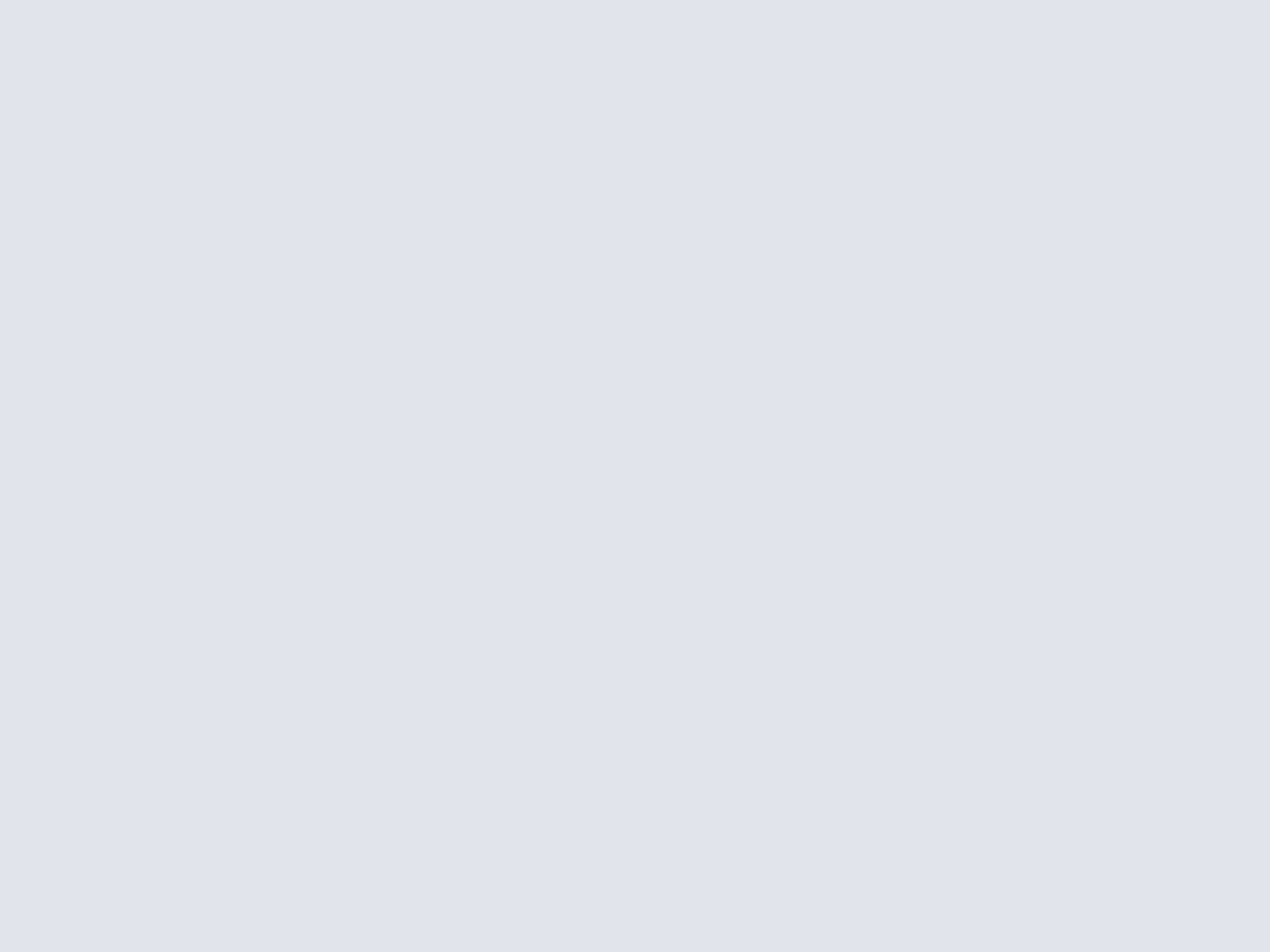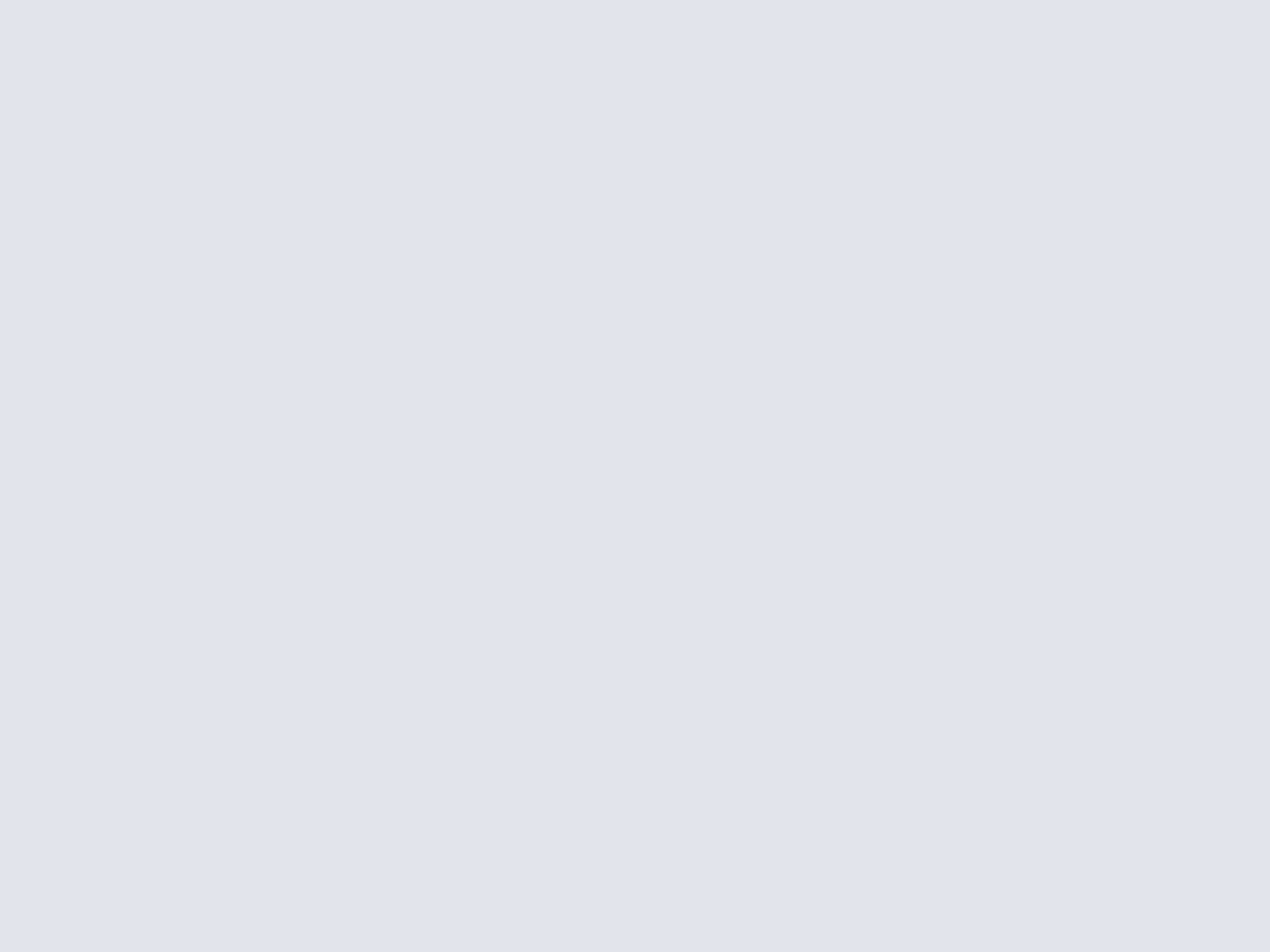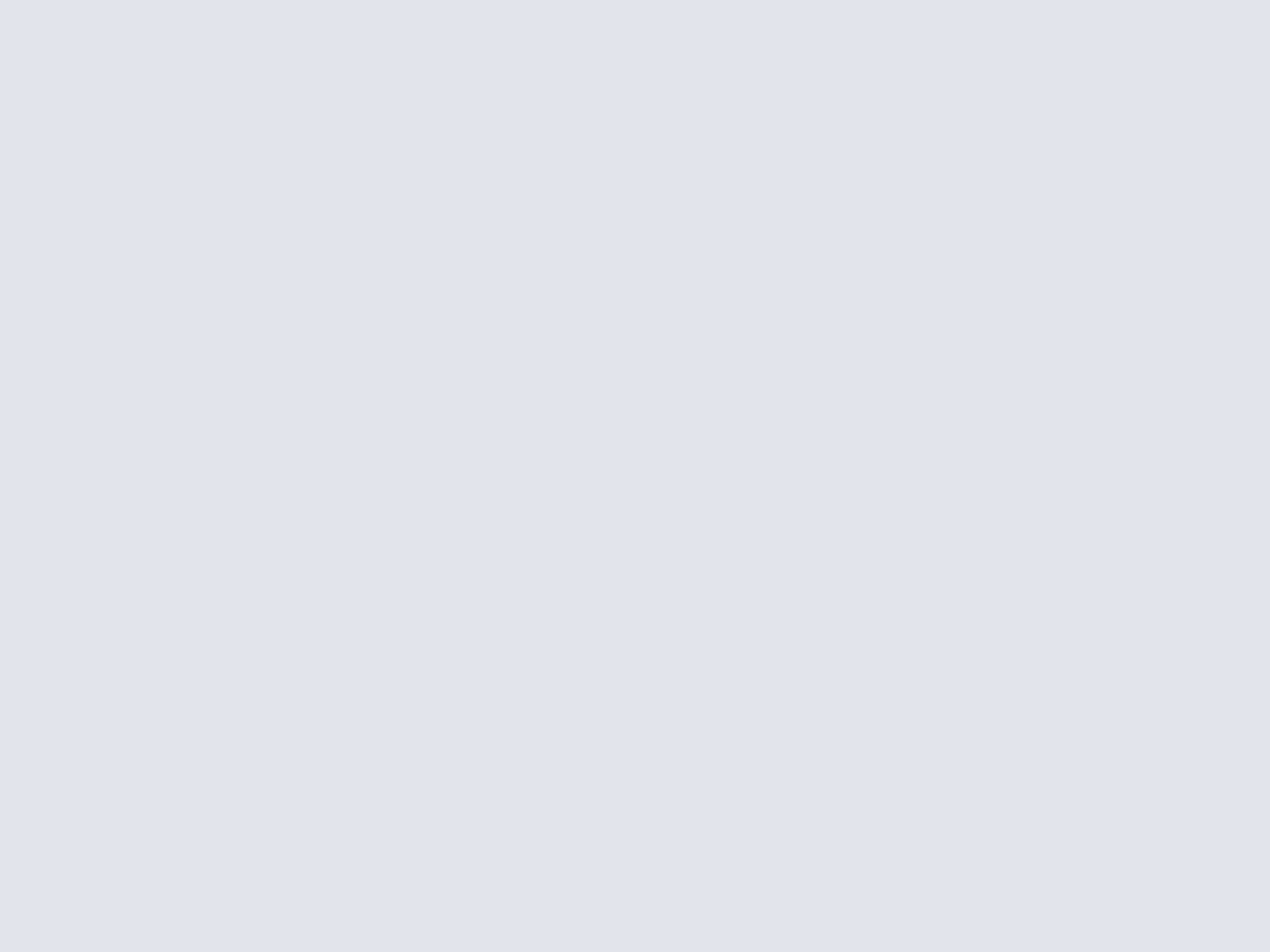De tout temps et dans toutes les civilisations, les hommes ont laissé des empreintes sur les murs. Des parois du Paléolithique aux murs de Pompéi, jusqu'au béton de nos cités ; à coups de canif, de burin ou de pinceau. La version moderne de cette forme d'expression populaire se développe à la fin des années 60 et prend de l'ampleur dans les années 70, notamment à New York, où elle participe à l'émergence du mouvement hip-hop. Ce que l'on nomme aujourd'hui street art ou art urbain est un mouvement artistique, héritier de cette culture populaire, mais aussi de l'art contemporain avec des artistes tels Andy Warhol, Keith Haring et Jean-Michel Basquiat, ou comme Jacques Villeglé, Ernest Pignon-Ernest, Paul Bloas ou Speedy Graphito pour citer quelques pionniers français. Il mêle diverses pratiques et techniques (gravure, craie, bombes, pochoir, marqueur...) et s'est aussi emparé d'outils contemporains et des technologies numériques.
De la trace anonyme au personal branding
Le graffiti, à l'origine, est une forme d'expression anonyme. C'est un message laissé aux passants, un témoignage, une revendication ou un geste artistique et poétique. Considéré comme illégal dans la plupart des pays, c'est aussi, souvent, un acte vandale, subversif, anti-système, qui revendique des espaces de liberté. Comme des superhéros, les artistes du graffiti ont une double activité. L'une est cachée, illégale, souvent nocturne, et s'affiche sauvagement sur les murs de nos villes. L'autre est plus officielle, commerciale, et dévoile parfois leur identité secrète.Car depuis une dizaine d'années, le street art s'institutionnalise. Il déborde des murs, s'installe dans des galeries et les musées (à la fondation Cartier en 2009, à l'espace Dali et à la fondation EDF actuellement). Et il se vend, très bien même, pour les artistes qui font le buzz ! Des œuvres du Britannique Banksy auraient ainsi rapporté plus de 3 500 000 euros dans les salles d'enchères en 2013-2014 selon Artprice. Cette popularité grandissante auprès du public et du marché de l'art doit beaucoup aux médias modernes.
Un mode de promotion viral et ludique
Car si l'art urbain a désormais une large audience, c'est grâce à internet et aux réseaux sociaux. Par nature, les pièces de street art sont libres, accessibles à tous. Dans la rue, elles touchent quelques milliers de passants, tout au plus, avant d'être recouvertes par d'autres, ou effacées par les services de voirie. Mais immortalisées par des capteurs d'appareils numériques et partagées sur les réseaux sociaux, elles deviennent visibles pour des millions d'internautes. Flickr, Facebook, Instagram ou Twitter regorgent d'archives numériques de cet art, autrefois éphémère.Pour ceux qui s'intéressent au street art, la ville est une galerie en plein air, mais aussi un terrain de jeu. Les règles : collectionner et partager les œuvres, identifier leurs auteurs. Pour assister cette quête, des applications mobiles géolocalisées ont vu le jour, hélas, pas toujours très abouties. Citons tout de même All City Street Art (iOS, en anglais) qui référence des œuvres du monde entier, MyParisStreetArt dédiée à notre capitale ou Urbacolors, une appli collaborative française, pour le moment encore incomplète et instable, mais prometteuse (une V2 est en préparation).
Une imagerie pop et geek
Héritier du pop-art autant que du graffiti, l'art urbain utilise à satiété l'imagerie de la culture pop. Les références à la culture geek sont donc légion : du comics à la science-fiction, Star Wars en tête, ou au jeu vidéo. Depuis la fin des années 90, l'artiste Invader colle sur les murs de nos villes des personnages issus de jeux rétros comme Space Invader. Plus de 3000 de ces créatures de pixel art, réalisées en mosaïque, ont déjà colonisé le monde selon un plan d'invasion stratégique, basé sur du scoring. Un autre mosaïste, Megamatt, fait aussi référence à l'univers du jeu vidéo. Ses pièces représentent des sprites de Megaman ou du héros de Flashback, Conrad B. Hart, qu'on découvre pendu à une gouttière ou accroupi au détour d'un coin de mur.Les œuvres de C215 ont, elles, fait le chemin inverse, du réel au virtuel. Contacté par Ubisoft, ce pochoiriste de renom a produit une série d'œuvres qui, une fois numérisées, ont intégré le décor du jeu Far Cry 4. Un autre artiste de rue, Mathieu Tremblin, lui, salue le monde en langage Basic sur des rideaux de fer, ou joue avec la sémantique en transformant un mur tagué de signatures en nuage de mots-clés. La référence à l'univers numérique peut aussi, parfois, être plus politique. Comme avec l'activiste finlandais Sampsa, qui dénonce dans ses pochoirs le travail des enfants ou l'obsolescence programmée et s'attaque au mythe de Steve Jobs ou à la Hadopi.
Du street art au street art 2.0
Historiquement, culture Web et graffitis défendent des valeurs communes, une certaine idée de la liberté d'expression et du partage, une défiance des institutions et un rejet des cadres et des barrières. Elles se retrouvent sur la toile, dans le monde des hackers et des crackers à travers l'art Ascii (images à base de lettres et caractères spéciaux), la démo scène ou le défacement de site Web par exemple. Cette pratique, qui consiste à pirater une page pour y laisser un message ou sa signature, peut ainsi être comparée au graffiti vandale tel que les pratiquent encore des artistes comme Kidult. Pour dénoncer la récupération du graffiti par le marché et par l'industrie du luxe, Kidult détourne des publicités et s'en prend violemment à des vitrines de boutiques qu'il défigure en quelques secondes, à coups d'extincteur rempli de peinture.Les artistes contemporains s'emparent aussi des technologies et du réseau pour produire leurs œuvres. Depuis le début des années 2000, l'artiste Blu donne vie à ses fresques dans d'étonnants et poétiques timelapses vidéo. Insa, lui, transforme ses murs peints en d'hypotoniques gifs animés et ses oeuvres ne deviennent vraiment visibles que sur le net. Du côté du Graffiti Research Lab, on met au point les outils du graffiti de demain, que chacun peut s'approprier, en développant des programmes et en détournant des technologies (peinture robotisée, barres de LEDs programmables pour le light painting...). Certains explorent aussi la notion de réalité augmentée à l'instar de Sweza qui placarde des QR Code dans la ville pour adresser des messages aux passants, diffuser des listes de lecture, détourner des panneaux publicitaires ou encore faire réapparaître, en photo, des graffitis effacés.
Pour d'autres, il s'agit de dénoncer l'appropriation de données et l'intrusion dans la vie privée. Ainsi Paulo Cirio, dans son projet Street Ghosts, colle sur les murs des silhouettes de passants, taille réelle et au même lieu, photographiés à leur insu dans Google Street View. Mise en abyme ironique, certains de ces collages sont à leur tour capturés par les Google Car et intégrés dans le service de cartographie. Tous ces exemples et ces pratiques nous dévoilent ce que sera le street art nouvelle génération. Un art en pleine effervescence, au cœur de l'art contemporain, qui fait sauter les frontières entre réel et virtuel, analogique et numérique, qui expérimente sans complexe et se prépare un avenir haut en couleur.