La dernière édition du PwC Global 100, ce grand classement mondial des éditeurs de logiciel est éloquent. Sans surprise, Microsoft est le premier éditeur de logiciel, devant IBM, Oracle puis SAP. Le premier français, Dassault Systèmes pointe en 16e position et Cegedim en 89e. La France ne compte que deux éditeurs dans le Top 100 alors que nos plus proches rivaux, l'Allemagne et le Royaume-Uni en comptent respectivement sept et huit.
Sans devoir remonter au « Plan Calcul » du Général de Gaulle dans les années 60, alors que dans les années 80/90 la France était considérée comme un leader du secteur informatique, que les pouvoirs publics préparaient une génération d'informaticiens avec leur plan « Informatique pour tous », comment se fait-il que la France n'ait pas réussi à placer plus d'éditeurs dans ce top 100 ?
Mis à part Dassault Systèmes, leader des solutions de CAO/PLM, et Cegedim, spécialisé dans les bases de données et logiciels de santé, la France ne place aucun de ses nombreux éditeurs d'ERP, de solutions de CRM ou de gestion logistique dans ce classement mondial. Quant à Business Objects, notre champion national dans le domaine de la Business Intelligence, un secteur en train d'exploser avec la vague du big data, il a été racheté par SAP en 2008.

La France a raté le boom du logiciel des années 80/90
« Nous sortons du traumatisme des années 80/90 où l'informatique en France a été trustée par les Bull, Thomson », accuse Alain Garnier, président d'EFEL Power, une association qui regroupe une centaine d'éditeurs français de tailles moyennes et petites. « Plutôt que se projeter dans un univers privé, l'Etat a soutenu ces géants qui ont siphonné l'argent public. On a construit des champions bâtis sur de fausses valeurs », déplore Alain Garnier. Il ajoute : « Alors que la France était une grande puissance informatique dans les années 80, les grands énarques placés à la tête de ces entreprises se sont avérés incapables de les diriger et les Américains ont pu s'imposer. »En outre, les entreprises françaises ont cette particularité de systématiquement vouloir adapter les logiciels qu'elles achètent à leur façon de fonctionner. Alors qu'une entreprise américaine va acheter le logiciel, le déployer et s'appuyer sur les processus proposés par l'éditeur pour l'exploiter au mieux, le DSI français demande des adaptations, des modifications parfois démesurées. « Pour la vente de 1 euro de licence Sinequa, il y avait de l'ordre de 5 à 6 euros de services associés », explique Philippe Laval, fondateur de Sinequa, éditeur de moteurs de recherche.

Alain Garnier, fondateur de Jamespot, milite dans le cadre de EFEL Power pour la création d'un modèle de développement alternatif au capital risque qui règne sur la Silicon Valley.
Cela explique qu'il y ait des sociétés de service aussi puissantes en France. Non seulement un éditeur américain peut s'appuyer sur un marché cinq à six fois plus gros que le marché français, mais il peut davantage se consacrer au développement de son produit selon sa stratégie, et non dépenser son énergie à plier son logiciel aux désirs des uns et des autres.
Ces années clés ont vu la naissance et l'explosion de géants du logiciel comme Microsoft, Oracle ou, plus près de nous en Europe, de SAP. Des situations de monopole de facto se sont mises en place et il est aujourd'hui bien difficile pour les nouveau entrants de se frayer un chemin dans les classements mondiaux, auprès des analystes des grands cabinets d'études américains. « Dans le numérique plus encore que dans d'autres secteurs, quand une situation de monopole s'est installée, c'est très difficile d'y mettre fin », observe Alain Garnier.
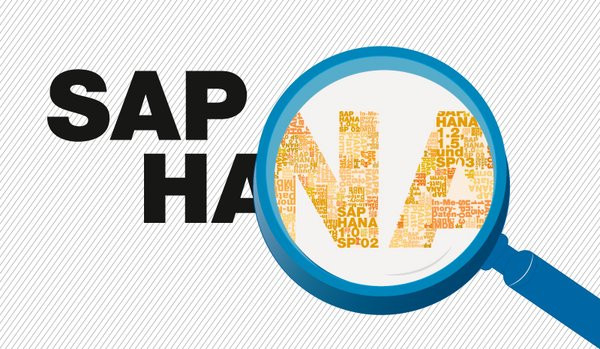
« 77% du logiciel acheté en France est d'origine américaine, or le logiciel, c'est l'actif numéro 1 de la transformation numérique. Il faut inverser cette tendance et pour cela, nous voulons gonfler l'écosystème des éditeurs français afin qu'ils grossissent et puissent rayonner à l'international. Association de start-up, France Digital a le même discours mais avec une approche très axée sur le capital risque. Pour nous, l'écosystème, c'est tant les start-up que les communautés open source, les entreprises en autofinancement. Nous ne sommes pas convaincus que seul le modèle de type Silicon Valley est le modèle gagnant ».
L'Etat a changé d'approche, mais les fonds disponibles restent insuffisants
Depuis ce virage raté des années 90, beaucoup d'efforts ont été déployés par les pouvoirs publics, les collectivités locales et par des opérateurs privés pour permettre aux créateurs de start-up de bénéficier de locaux et de financement pour lancer leur activité. On recense plus de 200 incubateurs en France et, à elle seule, Bpifrance, la Banque publique d'investissement de l'Etat français, a injecté 61 millions d'euros en investissement direct dans 45 entreprises au premier semestre 2015 et souscrit à hauteur de 354 millions d'euros dans 26 fonds d'investissement sur la même période, un record.
Le projet d'incubateur géant "1000 start-up" de Xavier Niel rejoindra plus de 200 incubateurs déjà ouverts en France.
« Le financement reste un gros problème tant en France qu'au niveau européen », prévient Jamal Labed, cofondateur d'EasyVista. « Pour construire un leader au niveau européen et mondial, il faut beaucoup d'argent. Le logiciel est une industrie très intensive en capital. Les levées de fonds se chiffrent maintenant en dizaines, voire centaines de millions d'euros et pour atteindre de tels niveaux, il faut un système de financement solide et bien en place ».
Président de l'AFDEL, association des éditeurs de logiciels, il souligne que si beaucoup de progrès ont été réalisés sur les phases les plus précoces de la création d'une start-up, c'est-à-dire sur les phases d'amorçage et sur le capital risque, les entrepreneurs peinent à passer à la vitesse supérieure lorsqu'il leur faut plusieurs dizaines de millions d'euros pour passer à une stratégie de développement d'envergure mondiale.

« Les entrepreneurs français ont aujourd'hui beaucoup de moyens pour financer leurs projets et la BPI fait bien son job. Le gros problème en France reste le milieu et la fin de la chaîne de financement. Pour lever des centaines de millions, il y a très peu de solutions en France et les grandes levées de fonds qui ont eu lieu dernièrement comme pour BlaBlaCar ou Sigfox ont été, pour une grande partie d'entre elles, réalisées grâce au capital risque étranger ».
Pour Jamal Labed, il manque à l'Europe une grande place boursière du type Nasdaq qui permettrait aux éditeurs européens et français de lever plusieurs centaines de millions d'euros, et donc permettre aux investisseurs qui ont injecté des dizaines de millions d'euros dans ces entreprises, de récupérer leurs mises avec une belle plus-value.
La reconquête du marché mondial passe par les Etats-Unis
Il y a entre 2 500 et 3 000 éditeurs de logiciels en France, dont beaucoup sont d'une taille très modeste par rapport aux standards internationaux. Sur le marché des logiciels B2B, l'Amérique du Nord représente de 40 à 50 % du marché mondial à elle seule alors que la mosaïque européenne pèse pour environ 30 %. La France constitue entre 5 à 7 % du gâteau mondial. Etre le champion national sur telle ou telle niche du marché français représente donc bien peu sur le plan mondial.Cette problématique, les dirigeants des éditeurs de logiciels français l'ont maintenant bien comprise et ceux-ci ont nettement changé d'approche ces dernières années. Beaucoup des éditeurs créés il y a dix, vingt ans cherchaient essentiellement à conquérir le marché français et n'envisageaient partir à la conquête des marchés étrangers qu'une fois leur marché intérieur saturé.
Une erreur stratégique estime aujourd'hui Philippe Laval, le fondateur de Sinequa : « Le marché français est suffisamment gros pour qu'on puisse commencer son activité en France avant de songer à se développer à l'international. Or, notre marché n'est pas assez grand pour acquérir une taille suffisante. On ne peut pas construire un géant du logiciel uniquement sur la France ».
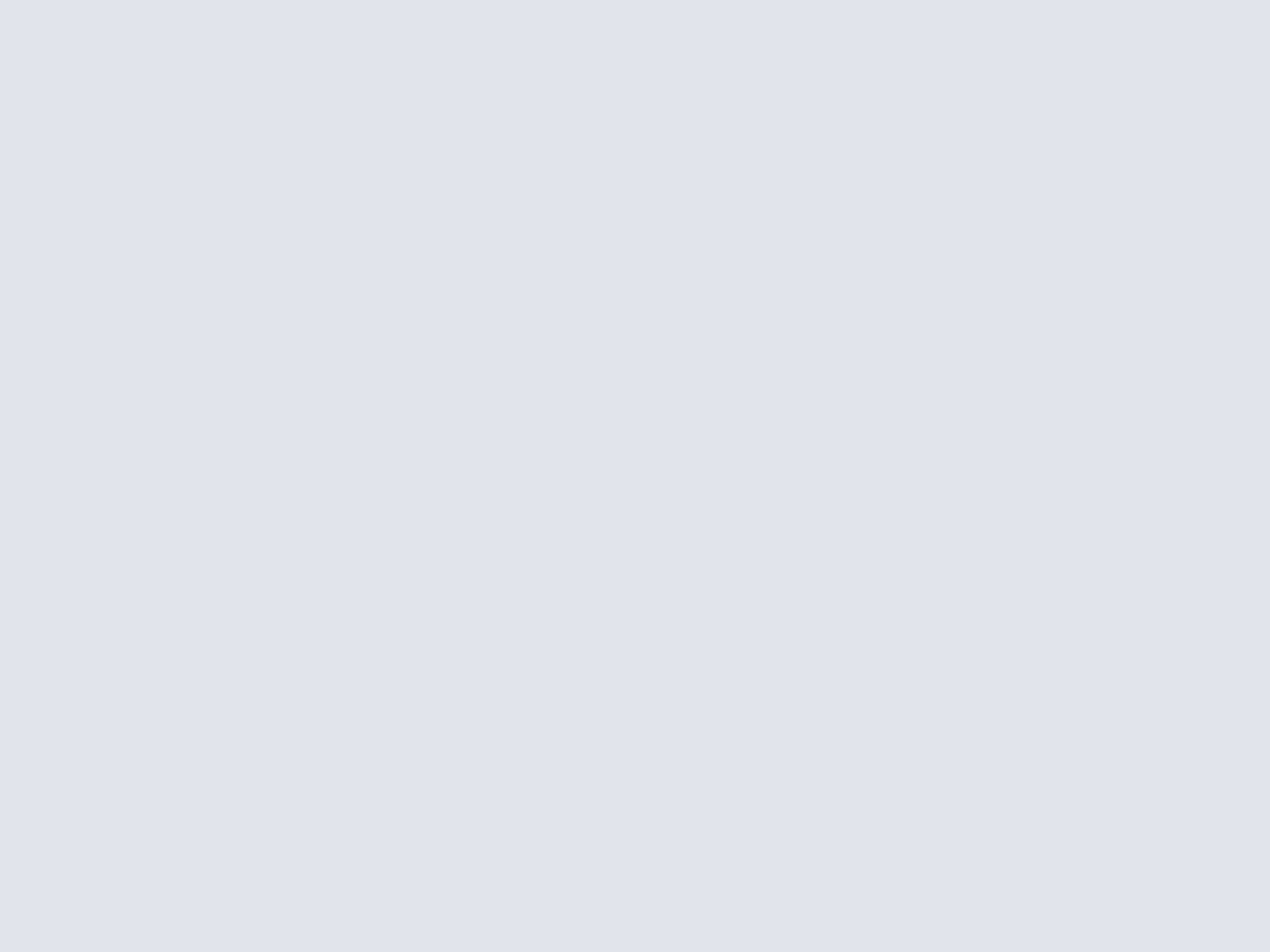
S'installer aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley, reste indispensable pour un éditeur qui veut séduire les fonds d'investissement américains.
Evoquant la période où il gérait Sinequa, il avoue avoir songé à véritablement aller sur les marchés étrangers que sept ans après la création de l'entreprise. « Toutes nos références clients étaient françaises, le marketing était français. Cela nous a pris sept ans de plus pour en faire une entreprise internationale. Pour réussir, il faut pratiquement devenir américain. Aujourd'hui, Sinequa connait le succès aux Etats-Unis avec un bureau à New-York et les grands cabinets américains Gartner et Forrester nous classent parmi les leaders. C'est donc possible d'y parvenir, mais c'est au prix de cette américanisation ».

Jamal Labed (EasyVista, AFDEL) milite pour la création d'un Nasdaq européen.
Pour Jamal Labed, cofondateur d'EasyVista et président de l'AFDEL, devenir un leader international dans son domaine est devenu impératif pour un éditeur de logiciel. « Ce n'est pas une figure de style, c'est devenu indispensable pour assurer la survie d'une entreprise dans une économie globalisée. Même si vos clients sont français, ceux-ci doivent se projeter à l'international et ils vous demandent de les suivre ».
De fait, beaucoup d'éditeurs français font le choix de mettre leur marketing, leur service commercial aux Etats-Unis. « D'une part le marché est vaste, c'est aussi un marché qui est extrêmement vertueux en ce sens que les clients vous font progresser et votre réputation s'y construit. Tous les grands cabinets d'analystes reconnus sont là-bas, donc la réputation d'un éditeur se construit avant tout aux Etats-Unis ». Par contre, beaucoup préfèrent maintenir leur R&D et surtout leurs précieux développeurs à Paris. Ceux-ci sont non seulement bien moins payés que leurs confrères de la Silicon Valley, mais surtout les managers ne veulent courir le risque de les voir partir chez Google, Apple ou Salesforce à peine le pied posé à San Francisco.
Les start-up françaises colonisent la Silicon Valley
Selon les chiffres communiqués par le consul de France à San Francisco, il y aurait environ 60 000 Français actuellement basés dans la Silicon Valley et plus largement sur la baie de San Francisco. Dans ce total, tous ne sont pas boulangers ou cuisiniers, loin de là. Entre 10 000 à 15 000 sont employés dans la high-tech. On les trouve à divers niveaux chez les géants du logiciel de la « Valley », mais aussi chez les nombreuses start-up françaises qui se sont tout, ou partie, délocalisées aux Etats-Unis pour changer de dimension.La liste des derniers nominés au FABA (French American Business Awards), oscars des entreprises françaises présentes aux Etats-Unis, est éloquent : Axway, Algolia, Eventbrite, Kwarter, Numberly, Scality, Squid Solutions, Talend, Stupeflix, etc. Les Français se bousculent dans les rues de San Francisco et certaines, comme Talend, ou Docker sont parvenues à atteindre ce statut de leader mondial dans leur domaine.

Philippe Laval, fondateur de Sinequa, a installé sa start-up Evercontact dans la Silicon Valley.
S'installer aux Etats-Unis, et plus particulièrement dans la Silicon Valley est indispensable pour accéder au premier marché mondial du logiciel, et pour bénéficier de cet écosystème de développement de start-up, unique au monde : « Les investisseurs que je rencontre me disent clairement qu'ils sont prêts à investir à partir du moment où notre structure est basée aux Etats-Unis », explique Philippe Laval qui installé sa nouvelle start-up Evercontact à San Francisco où il réside maintenant.
Contrairement à Sinequa, l'entrepreneur a choisi d'implanter immédiatement sa société qui édite un outil d'extraction des coordonnées d'un contact depuis un e-mail aux Etats-Unis afin d'accélérer sa croissance. Il fait actuellement la tournée des investisseurs de la « Valley » pour financer sa start-up. « En ce moment je fais des pitchs (présentations) sans arrêt auprès des investisseurs. La dernière fois, je suis passé entre un Suédois, un Allemand, un autre Français, un Hongrois, et... un Américain ! Il s'agissait d'un pitch « Serie A » tout ce qu'il y a de classique chez l'un des plus gros fonds de la Silicon Valley ».
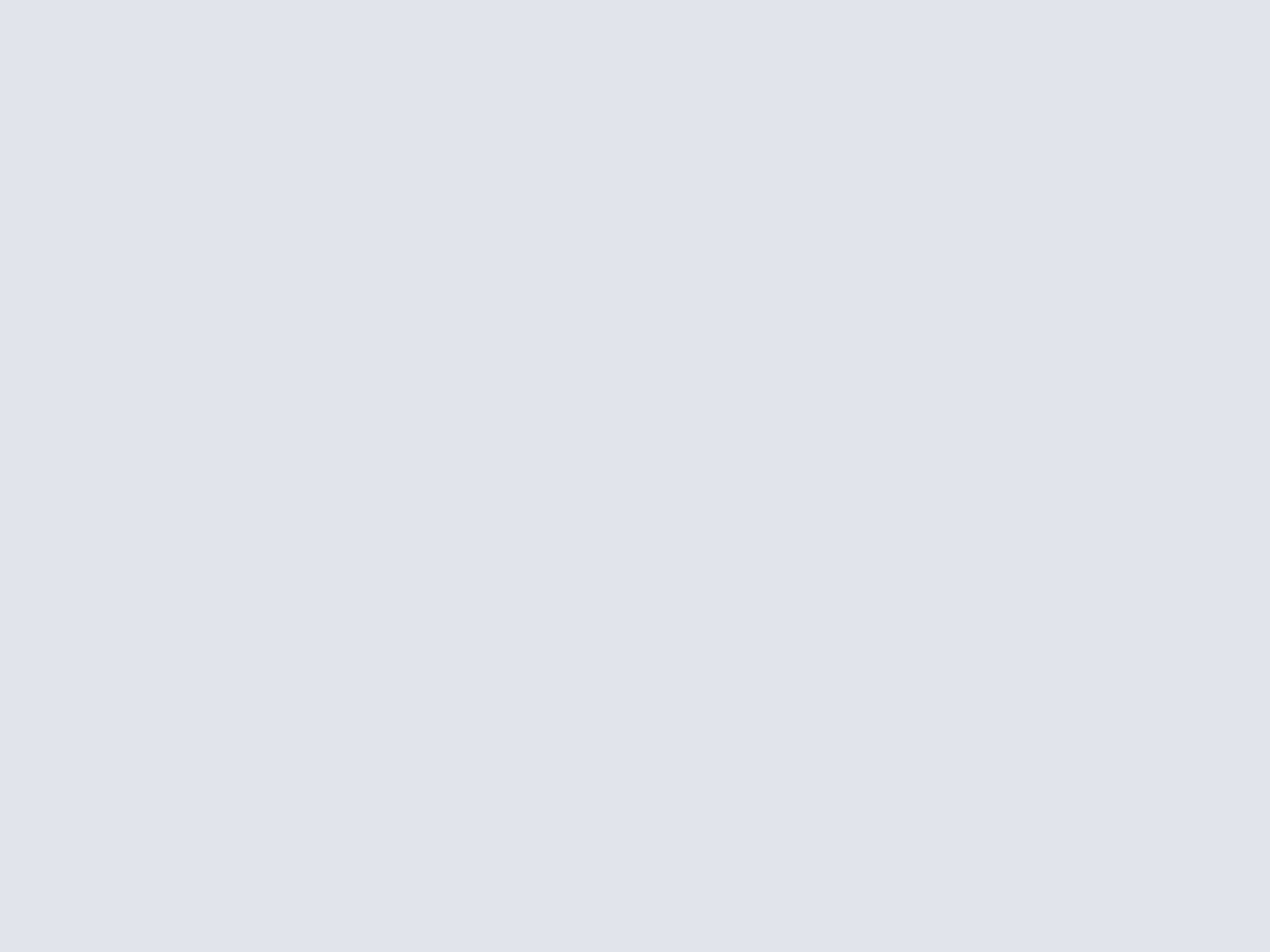
Toutes les start-up sont en train d'entrer dans le moule de la Silicon Valley pour pouvoir connaître un destin à la Workday, éditeur de solution RH dans le Cloud qui, après avoir bénéficié de 175 millions de dollars auprès d'investisseurs à levé plus de 732 millions de dollars à la bourse en 2012. Le français Talend créé par Bertrand Diard et Fabrice Bohan est aujourd'hui basé à Redwood, en Californie.
Cet éditeur de solutions d'intégration Open Source a déjà réalisé six levées de fonds, pour un total de plus de 101 millions de dollars. La prochaine étape de son développement passe par la mythique « IPO », l'introduction en bourse au Nasdaq, synonyme de jackpot pour les fondateurs de start-up.
A lire également
